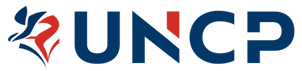Émile Friol, la pureté de la foudre
Il était maigre et nerveux, et plus bondissant qu’un guépard. Dix années durant, il multiplia les sprints, devenant cinq fois champion de France et deux fois champion du monde de vitesse. Portrait du Rhodanien Émile Friol…
Lui aussi était un géant… On ne parle certes pas du physique : une silhouette de chat, dans laquelle on peinait à deviner un sprinter ! C’est au point que Pierre Chany put écrire, pour légender son portrait : « le Rhodanien semblait dépourvu de musculature, il était efflanqué, sec comme un sarment des coteaux de Cornas, mais son influx nerveux le rendait spectaculaire et toujours dangereux pour les meilleurs. »[1] De fait, un homme dangereux, que l’on pouvait mêmement comparer à un à funambule tant il donnait l’impression d’évoluer sur le fil… Mais son fil était celui d’une dague ; et rien ne fut plus tranchant que ses attaques ! D’où l’idée, bientôt admise par tous, qu’Émile Friol tenait finalement du guépard. On veut dire : une manière de hauteur, une fausse nonchalance, et puis, subitement, un bond formidable qui laissait le public bouche bée, à une époque où les ralentis n’existaient pas ! Avait-on bien vu ? Chacun se frottait les yeux, s’étonnant que Friol, il y a quelques instants encore, était le dernier des trois coureurs en piste. Puis, comme d’autres appuyaient sur une gâchette, il avait poussé fort sur ses pédales, surpassant littéralement ses rivaux. Souvent, le Danois Thorvald Ellegaard, six fois champion du monde, dut lui rendre les armes.
Oh ! que de matchs ces deux-là se livraient… Fidèle à sa méthode — « Pour ma part, j’aime mieux prendre franchement la tête »[2] —, Ellegaard augmentait progressivement l’allure, servi par des jambes longues et puissantes. Des dizaines de clichés l’ont montré en action : au sens propre, un Viking, blond, froid, le masque impénétrable, le chef légèrement tourné sur la droite, guettant la seconde où Friol s’élancerait… Et derrière, sa roue touchant la sienne, un fauve, mince, brun, fiévreux... Impossible d’imaginer deux compétiteurs plus différents, et des combats plus acharnés. Car Friol d’un coup se jetait, dans une sorte de rage désespérée. Ainsi le coiffa-t-il, en 1908, 1910 et 1911, au terme du très réputé Grand Prix de l’U.V.F., traditionnellement disputé sur 1 000 mètres. Et il avait remporté, de la même façon, le Grand Prix de Paris en 1907 (devant Dupré), en 1909 (devant Rütt) et en 1910 (devant Rütt encore), prouvant, si nécessaire, une constance inattendue chez ce vif-argent… C’est du reste ce qui épate à l’heure du bilan : il a su durer, et prendre la mesure de n’importe quel pistard, alors que la règle voulait que les sprinters tout en nerfs disparussent assez vite. Mais, Émile Friol, répétons-le, n’incarnait pas un bois ordinaire ! Le « sarment » dont parlait Chany était un sceptre.
À quel moment ce jeune homme, né le 6 mars 1881 à Tain l’Hermitage, comprit-il qu’il serait appelé à régner ? Sans doute un soir de 1904, après qu’il eut décroché son premier titre national en vitesse. Il avait donc vingt-trois ans, l’âge des audaces et des chimères. Pourquoi aborda-t-il l’ultime virage, sur la piste du Parc des Princes, si mal placé, en cinquième position ? Le temps que l’on s’interroge, il avait déjà démarré, remontant quatre coureurs en moins de cent mètres, pour finir avec trois longueurs d’avance sur Piard et Poulain ! Évidemment, d’aucuns écarquillèrent les yeux : un inconnu sacré champion de France ! Un inconnu auteur d’un exploit sidérant — un exploit tellement incroyable que les observateurs, dans leurs commentaires, ranimèrent le souvenir d’un certain Arthur-Augustus Zimmermann, invraisemblable prodige du cyclisme…
Pour Émile Friol, le plus difficile commençait. Serait-il au niveau des promesses qu’il avait semées ? Parce que la concurrence s’annonçait extrêmement rude, et à l’échelon national, et sur le plan international. Côté français, par exemple, on assistait à l’épanouissement de Gabriel Poulain, tour à tour champion de France et champion du monde en 1905… Comment départager les deux vedettes ? Friol apporta la réponse dès la saison suivante : un énième bond surpuissant, qui obligea le madré Poulain à baisser pavillon ! Puis, en 1907, dans un Parc des Princes archi-comble, il bondit à nouveau, surprenant son rival par une accélération foudroyante. Les spécialistes firent le compte : trois maillots tricolores en quatre ans ! Mais le meilleur était à venir puisque le Français, devenu également champion d’Europe en cette année 1907, s’imposa d’enlever le championnat du monde, organisé à Paris… On imagine l’affiche, la tension, le frisson des tribunes. Concentré comme jamais, Émile Friol réalisa un sans-faute jusqu’à la finale où il se trouva opposé à l’Allemand Henri Mayer, vieux baroudeur du circuit. Puis, dans le dernier tour, pareil au jeune dieu qu’il n’avait cessé d’être, il déborda son adversaire. Son œuvre était faite.
Que lui restait-il à gagner ? Il possédait tout, et d’abord l’admiration du public, celui-ci largement acquis à sa cause. Pour résumer le sentiment général, mettons qu’Émile Friol continuait de symboliser, malgré ses victoires, le mythe d’un David efflanqué, qui se mesurait à Goliath ! Or, derrière une sobriété de moyens, l’intéressé cachait une force supérieure : la pureté de la foudre… Ce qui le rendait, non point invincible, mais redoutable, et redouté, chaque fois qu’il montait en selle. Aussi triompha-t-il dans un deuxième championnat d’Europe et un deuxième championnat du monde en 1910, dans un quatrième et cinquième championnat de France en 1910 et 1913. Nous l’avons dit : ce vif-argent savait durer, fabuleusement.
Hélas, il tomba, comme Hourlier, comme Lapize, comme Faber, comme tant d’autres, dans la nuit de la Grande Guerre.
© Christophe Penot
Retrouvez chaque mois la suite de cette série de portraits dans La France Cycliste,
le magazine officiel de la Fédération Française de Cyclisme.
Émile Friol en bref
- Né le 9 mars 1881 à Lyon. Décédé sous l’uniforme le 16 novembre 1916 à Amiens, des suites d’un accident de moto à Dury.
- Principales victoires : Championnat du monde 1907 et 1910 (troisième en 1906) ; Championnat d’Europe 1907 et 1910 ; Championnat de France 1904, 1906, 1907, 1910 et 1913 ; Grand Prix de Paris 1907, 1909 et 1910 ; Grand Prix de la République 1908 ; Grand Prix de l’U.V.F. 1908, 1910 et 1911; Grand Prix de France 1906, 1907, 1910, 1911, 1912 et 1914.
[1] Pierre Chany, La Fabuleuse histoire du cyclisme, ODIL, p. 271.
[2] Marcel Viollette, Le Cyclisme, Éd. Pierre Lafitte & Cie, p. 205.
Émile Friol, la pureté de la foudre
Il était maigre et nerveux, et plus bondissant qu’un guépard. Dix années durant, il multiplia les sprints, devenant cinq fois champion de France et deux fois champion du monde de vitesse. Portrait du Rhodanien Émile Friol…
Lui aussi était un géant… On ne parle certes pas du physique : une silhouette de chat, dans laquelle on peinait à deviner un sprinter ! C’est au point que Pierre Chany put écrire, pour légender son portrait : « le Rhodanien semblait dépourvu de musculature, il était efflanqué, sec comme un sarment des coteaux de Cornas, mais son influx nerveux le rendait spectaculaire et toujours dangereux pour les meilleurs. »[1] De fait, un homme dangereux, que l’on pouvait mêmement comparer à un à funambule tant il donnait l’impression d’évoluer sur le fil… Mais son fil était celui d’une dague ; et rien ne fut plus tranchant que ses attaques ! D’où l’idée, bientôt admise par tous, qu’Émile Friol tenait finalement du guépard. On veut dire : une manière de hauteur, une fausse nonchalance, et puis, subitement, un bond formidable qui laissait le public bouche bée, à une époque où les ralentis n’existaient pas ! Avait-on bien vu ? Chacun se frottait les yeux, s’étonnant que Friol, il y a quelques instants encore, était le dernier des trois coureurs en piste. Puis, comme d’autres appuyaient sur une gâchette, il avait poussé fort sur ses pédales, surpassant littéralement ses rivaux. Souvent, le Danois Thorvald Ellegaard, six fois champion du monde, dut lui rendre les armes.
Oh ! que de matchs ces deux-là se livraient… Fidèle à sa méthode — « Pour ma part, j’aime mieux prendre franchement la tête »[2] —, Ellegaard augmentait progressivement l’allure, servi par des jambes longues et puissantes. Des dizaines de clichés l’ont montré en action : au sens propre, un Viking, blond, froid, le masque impénétrable, le chef légèrement tourné sur la droite, guettant la seconde où Friol s’élancerait… Et derrière, sa roue touchant la sienne, un fauve, mince, brun, fiévreux... Impossible d’imaginer deux compétiteurs plus différents, et des combats plus acharnés. Car Friol d’un coup se jetait, dans une sorte de rage désespérée. Ainsi le coiffa-t-il, en 1908, 1910 et 1911, au terme du très réputé Grand Prix de l’U.V.F., traditionnellement disputé sur 1 000 mètres. Et il avait remporté, de la même façon, le Grand Prix de Paris en 1907 (devant Dupré), en 1909 (devant Rütt) et en 1910 (devant Rütt encore), prouvant, si nécessaire, une constance inattendue chez ce vif-argent… C’est du reste ce qui épate à l’heure du bilan : il a su durer, et prendre la mesure de n’importe quel pistard, alors que la règle voulait que les sprinters tout en nerfs disparussent assez vite. Mais, Émile Friol, répétons-le, n’incarnait pas un bois ordinaire ! Le « sarment » dont parlait Chany était un sceptre.
À quel moment ce jeune homme, né le 6 mars 1881 à Tain l’Hermitage, comprit-il qu’il serait appelé à régner ? Sans doute un soir de 1904, après qu’il eut décroché son premier titre national en vitesse. Il avait donc vingt-trois ans, l’âge des audaces et des chimères. Pourquoi aborda-t-il l’ultime virage, sur la piste du Parc des Princes, si mal placé, en cinquième position ? Le temps que l’on s’interroge, il avait déjà démarré, remontant quatre coureurs en moins de cent mètres, pour finir avec trois longueurs d’avance sur Piard et Poulain ! Évidemment, d’aucuns écarquillèrent les yeux : un inconnu sacré champion de France ! Un inconnu auteur d’un exploit sidérant — un exploit tellement incroyable que les observateurs, dans leurs commentaires, ranimèrent le souvenir d’un certain Arthur-Augustus Zimmermann, invraisemblable prodige du cyclisme…
Pour Émile Friol, le plus difficile commençait. Serait-il au niveau des promesses qu’il avait semées ? Parce que la concurrence s’annonçait extrêmement rude, et à l’échelon national, et sur le plan international. Côté français, par exemple, on assistait à l’épanouissement de Gabriel Poulain, tour à tour champion de France et champion du monde en 1905… Comment départager les deux vedettes ? Friol apporta la réponse dès la saison suivante : un énième bond surpuissant, qui obligea le madré Poulain à baisser pavillon ! Puis, en 1907, dans un Parc des Princes archi-comble, il bondit à nouveau, surprenant son rival par une accélération foudroyante. Les spécialistes firent le compte : trois maillots tricolores en quatre ans ! Mais le meilleur était à venir puisque le Français, devenu également champion d’Europe en cette année 1907, s’imposa d’enlever le championnat du monde, organisé à Paris… On imagine l’affiche, la tension, le frisson des tribunes. Concentré comme jamais, Émile Friol réalisa un sans-faute jusqu’à la finale où il se trouva opposé à l’Allemand Henri Mayer, vieux baroudeur du circuit. Puis, dans le dernier tour, pareil au jeune dieu qu’il n’avait cessé d’être, il déborda son adversaire. Son œuvre était faite.
Que lui restait-il à gagner ? Il possédait tout, et d’abord l’admiration du public, celui-ci largement acquis à sa cause. Pour résumer le sentiment général, mettons qu’Émile Friol continuait de symboliser, malgré ses victoires, le mythe d’un David efflanqué, qui se mesurait à Goliath ! Or, derrière une sobriété de moyens, l’intéressé cachait une force supérieure : la pureté de la foudre… Ce qui le rendait, non point invincible, mais redoutable, et redouté, chaque fois qu’il montait en selle. Aussi triompha-t-il dans un deuxième championnat d’Europe et un deuxième championnat du monde en 1910, dans un quatrième et cinquième championnat de France en 1910 et 1913. Nous l’avons dit : ce vif-argent savait durer, fabuleusement.
Hélas, il tomba, comme Hourlier, comme Lapize, comme Faber, comme tant d’autres, dans la nuit de la Grande Guerre.
© Christophe Penot
Retrouvez chaque mois la suite de cette série de portraits dans La France Cycliste,
le magazine officiel de la Fédération Française de Cyclisme.
Émile Friol en bref
- Né le 9 mars 1881 à Lyon. Décédé sous l’uniforme le 16 novembre 1916 à Amiens, des suites d’un accident de moto à Dury.
- Principales victoires : Championnat du monde 1907 et 1910 (troisième en 1906) ; Championnat d’Europe 1907 et 1910 ; Championnat de France 1904, 1906, 1907, 1910 et 1913 ; Grand Prix de Paris 1907, 1909 et 1910 ; Grand Prix de la République 1908 ; Grand Prix de l’U.V.F. 1908, 1910 et 1911; Grand Prix de France 1906, 1907, 1910, 1911, 1912 et 1914.
[1] Pierre Chany, La Fabuleuse histoire du cyclisme, ODIL, p. 271.
[2] Marcel Viollette, Le Cyclisme, Éd. Pierre Lafitte & Cie, p. 205.